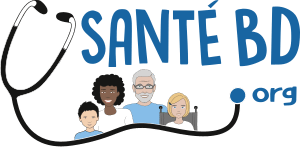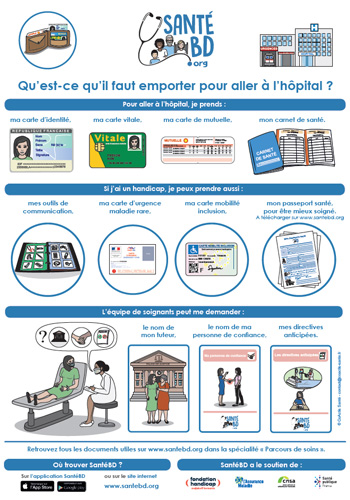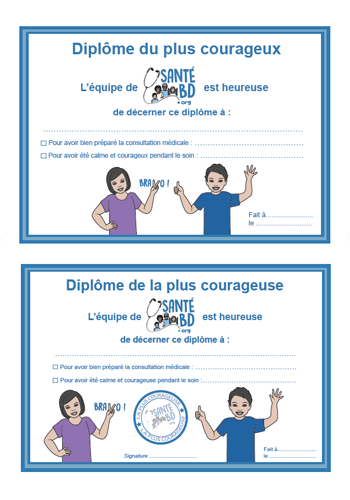Le plâtre – La pose du plâtre
1. Je personnalise la BD :
2. Je découvre le contenu de la BD :
2. Je découvre la BD :
Cette bande dessinée est déclinée dans d'autres formats
Ces bandes dessinées pourraient vous intéresser...
-
BD personnalisableLe plâtre – Vivre avec mon plâtre
-
BD personnalisableLe plâtre – On m’enlève mon plâtre
-
BD personnalisableLes urgences – Prévenir et aller aux urgences
-
BD personnalisableLes urgences – Comment ça se passe ?
Plus d'informations sur la BD
Vous vous êtes cassé un os ? Vous devez porter un plâtre et vous vous demandez comment va se passer la pose ? Vous voulez rassurer votre enfant qui a peur d’avoir mal pendant la pose du plâtre ?
Dans cette BD, découvrez les étapes de la pose d’un plâtre et les bons gestes à adopter juste après la pose.
A quoi sert un plâtre ?
La pose d’un plâtre médical a pour but d’immobiliser une partie du corps de façon stable jusqu’à :
- consolidation d’un os en cas de fracture stable et réduite. On ne peut pas poser de plâtre sur une fracture déplacée dans laquelle les fragments osseux ne sont pas positionnés dans leur localisation anatomique normale.
- cicatrisation du ligament en cas d’entorse, de luxation ou d’arthrite. Il est cependant de plus en plus rare de poser un plâtre pour une entorse, on préfère les attelles, à l’exception des entorses graves.
- consolidation d’une ostéosynthèse après opération chirurgicale sous anesthésie.
Avoir un plâtre peut être inconfortable car les mouvements sont limités, mais ne doit pas faire mal.
La pose d’un plâtre est un acte médical qui engage la responsabilité du soignant et nécessite une surveillance. Elle expose à des risques de complications, comme toute thérapeutique.
Qu’est-ce qu’une fracture ?
Un os fracturé est un os sectionné. Une fracture peut être :
- ouverte (l’os est mis à nu) ou fermée ;
- comminutive : elle est constituée de petits fragments ;
- associée à des lésions vasculaires ;
- associée à des lésions nerveuses.
Une fracture survient suite à un choc direct ou indirect, ou encore suite à la sollicitation de l’os en flexion ou en torsion.
Qu’est-ce qu’une luxation ?
La luxation correspond à une perte de contact entre les différentes surfaces articulaires. Une articulation est la zone de jonction entre différents os. On peut par exemple se luxer l’épaule ou le coude.
Qu’est-ce qu’une entorse ?
L’entorse correspond à l’étirement ou à la déchirure d’un ou de plusieurs ligaments d’une articulation. Les ligaments sont des faisceaux de fibres permettant de maintenir deux os ensemble à la jonction d’une articulation.
Les entorses de la cheville sont fréquentes.
Qu’est-ce qu’une arthrite ?
Une arthrite est une inflammation de l’articulation. C’est le signe clinique de nombreuses maladies articulaires comme l’arthrose. Une arthrite peut être aiguë ou chronique.
Qu’est-ce qu’une ostéosynthèse ?
L’ostéosynthèse désigne l’ensemble des méthodes chirurgicales utilisées pour traiter les fractures et d’autres problèmes du système musculo-squelettique. Ces approches requièrent du matériel particulier comme des vis, des plaques, des clous ou encore des broches qui peuvent être positionnés à l’intérieur ou à l’extérieur du membres (fixateurs externes). L’ostéosynthèse est réalisée sous anesthésie.
En quelle matière est le plâtre médical ?
Il existe plusieurs sortes de plâtre :
- en plâtre. En réalité, il s’agit de bandes imprégnées de plâtre. Elles peuvent mettre deux jours à sécher et sont assez lourdes.
- en synthétique, soit en résine soit une fibre de verre. Ils sèchent en quelques minutes et deviennent durs en quelques heures.
C’est pourquoi il existe des plâtres blancs et des plâtres colorés.
Qui peut poser un plâtre ?
Les personnes autorisées à poser un plâtre sont le médecin, l’infirmière et les étudiants en médecine formés.
Comment se passe la pose d’un plâtre ?
Pour se faire poser un plâtre, une infirmière vous accueille. Vous devez enlever vos bijoux (bagues, bracelets, etc.). Elle place votre membre dans la bonne position. Vous ne devez pas bouger pendant qu’elle vous fait le plâtre. Pour vous aider, vous pouvez tenir votre membre ou quelqu’un peut vous aider à le tenir.
L’infirmière prend un jersey renforcé par du coton de protection et l’enfile sur votre membre. Elle met des gants, trempe le rouleau de plâtre dans de l’eau, enroule des bandes de plâtre autour de votre membre, passe ses mains mouillées dessus. Le plâtre devient lisse et très chaud. Le plâtre tient évidemment compte de votre anatomie.
Le plâtre est posé : il va sécher doucement. Vous ne devez pas toucher le plâtre pendant qu’il sèche afin de ne pas créer de compression. Il faut une journée et une nuit pour que le plâtre sèche s’il est en plâtre et quatre heures s’il est en résine.
Vous devez faire contrôler votre plâtre dans les 24 à 48 heures après la pose auprès d’un docteur. Il vous expliquera comment vivre avec votre plâtre et les signes cliniques qui doivent vous alerter et motiver une consultation. Toutes ces consignes figurent sur un document écrit qui vous sera remis au moment de la pose du plâtre.
Comment vivre avec un plâtre ?
Vivre avec un plâtre n’est pas toujours aisé : se déplacer, travailler, se doucher, etc. Le médecin ou la personne qui a posé le plâtre peut vous donner des conseils pour mieux vivre avec votre plâtre.
Sachez qu’en cas de problème, votre plâtre pourra être retiré. On parle d’ablation du plâtre. En effet, avoir un plâtre n’est pas sans risque et expose à des complications qui peuvent être graves et irréversibles.
Quelles sont les possibles complications d’un plâtre ?
Il existe différentes complications possibles du plâtre médical. Elles peuvent être dépistées et traitées précocement, c’est pourquoi le patient plâtré doit non seulement être surveillé, mais doit aussi connaître les signes d’alerte qui doivent motiver une consultation.
Porter un plâtre peut provoquer une compression au niveau de toutes les parties molles : peau, muscles, nerfs et vaisseaux sanguins. La compression vasculaire notamment peut mettre en grave danger le patient et entraîner des séquelles irréversibles.
Qu’est-ce qu’une compression cutanée ?
En comprimant la peau, le plâtre peut entraîner un simple érythème (rougeur de la peau, diffuse ou localisée). Mais celui-ci peut évoluer vers une phlyctène, aussi appelée ampoule (une collection de liquide sous la peau se forme) voire même vers une escarre (nécrose de la peau).
C’est pourquoi toute douleur, démangeaison ou mauvaise odeur doit alerter et mener à l’ablation du plâtre afin de vérifier l’état de la peau.
Qu’est-ce qu’une compression musculaire ?
Une compression musculaire va se traduire par une réduction de la mobilité des extrémités ou des troubles de la sensibilité. L’ablation du plâtre doit être réalisée afin de vérifier la présence d’un syndrome des loges.
Les loges sont les ensembles de tissus musculaires, de veines, d’artères et de nerfs. Lorsque la pression au sein de ces loges augmente, on parle de syndrome des loges qui est une pathologie grave. Si un syndrome des loges est diagnostiqué, il est nécessaire de réaliser un geste chirurgical appelé l’aponévrotomie de décompression. Sous anesthésie locorégionale, le chirurgien vient inciser la loge comprimée de sorte à libérer le corps musculaire.
Qu’est-ce qu’une compression veineuse ?
L’immobilisation dans un plâtre favorise la survenue de maladies thromboemboliques veineuses (MTV ou MTEV) à cause de la stagnation du sang ou stase veineuse. Il peut s’agir de :
- la thrombose veineuse profonde (TVP). Aussi appelée phlébite, elle est due à la présence d’un caillot sanguin (thrombus) dans une veine profonde des membres inférieurs.
- l’embolie pulmonaire. C’est la complication d’une thrombose veineuse profonde. Elle survient lorsque le caillot de sang se déplace dans une artère pulmonaire.
Pour prévenir ces risques, il est possible de prescrire différents traitements durant toute la durée du plâtre. Cependant une personne peut développer une maladie thromboembolique veineuse même sous traitement.
Des signes comme une douleur et une hyperthermie modérée (augmentation de la température du corps) avec augmentation du pouls doivent alerter. Un examen d’imagerie médicale comme une échographie doppler ou une phlébographie doit être réalisé. Si une maladie thromboembolique est détectée, il faut mettre en place un traitement curatif et retirer le plâtre si cela est possible.
Qu’est-ce qu’une compression artérielle ?
La compression artérielle se traduit par un syndrome de Volkman qui se manifeste par des douleurs au niveau de l’avant-bras et des troubles de la sensibilité des doigts (paresthésie : fourmillement, picotement, engourdissement, etc.). Si la compression se prolonge, on peut risquer des séquelles irréversibles à long terme au niveau de la mobilité des os et des articulations.
Quels sont les risques de retard de consolidation ?
Si la fracture prend plus de temps qu’escompté à consolider, il y a un risque de pseudarthrose dont les signes sont des douleurs chroniques et une gêne dans la mobilité de la zone concernée.
Un retard de consolidation n’entraîne pas systématiquement une pseudarthrose.
Quels sont les traitements de la pseudarthrose ?
Le traitement de la pseudarthrose dépend de sa nature :
- pseudarthrose hypertrophique. On peut proposer une greffe de l’os, souvent à partir de l’os du bassin. Une ostéosynthèse (chirurgie) peut également être pratiquée : du matériel de type plaque ou clou vient fixer et immobiliser les os.
- pseudarthrose septique. Il faut alors d’abord soigner l’infection (généralement due à une bactérie), retirer les tissus infectés et mettre en place une antibiothérapie. Puis on peut installer une broche ou un fixateur externe pendant plusieurs mois.