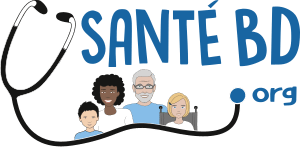Vous vous demandez si vous bougez assez au quotidien ? Vous ne savez pas par où commencer pour intégrer davantage de sport dans votre vie ? Vous voulez mieux comprendre le lien entre activité physique et santé ?
Dans cette BD, découvrez pourquoi il est important de bien bouger pour votre santé, comment trouver une activité physique qui vous convienne et être moins sédentaire.
Qu’est-ce que l’activité physique ?
Avoir une activité physique, c’est bouger : marcher, faire du vélo, passer l’aspirateur, faire la cuisine, jardiner, laver les vitres, danser, faire de la gym, jouer au ballon, nager, courir, aller à la salle de sport… Les activités physiques peuvent concerner les déplacements du quotidien, la vie domestique, les loisirs et la vie professionnelle et scolaire.
Quelle est la différence entre sport et activité physique ?
L’activité physique est plus large que le sport car elle englobe les activités du quotidien. Le sport est une activité physique qui nécessite de respecter des règles, avec un objectif de jeu et d’effort.
Pourquoi est-ce important de pratiquer une activité physique ?
Pratiquer une activité physique est bon pour la santé ! En particulier, l’activité physique renforce le cœur et les vaisseaux sanguins, augmente la masse musculaire, réduit la masse grasse, entretient les os et les articulations, améliore la ventilation pulmonaire… Elle contribue à prévenir le risque de développer certaines maladies non transmissibles comme une maladie cardiovasculaire (hypertension artérielle, infarctus du myocarde…), une obésité, un diabète de type 2, un cancer, une ostéoporose, une arthrose… Elle réduit les symptômes de la dépression et de l’anxiété et améliore les capacités de réflexion et d’apprentissage. Pratiquer une activité physique aide aussi à mieux dormir, mieux digérer, et se sentir mieux dans sa tête. Finalement, l’activité physique améliore le bien-être en général !
Pourquoi l’activité physique permet-elle de réduire le stress ?
L’activité physique agit sur le stress via la production d’hormones appelées les endorphines. Elles génèrent une sensation de bien-être. Par ailleurs, prendre du temps pour bouger permet de concentrer son mental sur le moment présent, loin des soucis du quotidien. C’est particulièrement le cas si l’on se trouve dans la nature.
Quels sont les risques si je ne fais pas de sport ?
On dit qu’une personne est sédentaire lorsqu’elle ne bouge pas assez. Cela correspond à beaucoup de situations de vie où l’on est immobile en position assise ou allongée : se déplacer en voiture, travailler ou étudier, passer du temps devant des écrans, patienter dans une file d’attente… La sédentarité est un facteur de risque de nombreuses maladies chroniques : diabète, hypertension artérielle, insuffisance rénale et cardiaque, obésité, cancer du côlon… D’ailleurs, pratiquer une activité physique fait partie du plan de traitement de bon nombre de ces pathologies. Par ailleurs, le manque d’activité physique favorise la fonte musculaire et augmente le taux de graisse dans le corps.
Comment bouger davantage au quotidien ?
Pour intégrer davantage de mouvement dans votre quotidien, pensez à vous déplacer à pied ou à vélo plutôt qu’en voiture, par exemple pour aller au travail ou faire les courses. Préférez les escaliers à l’ascenseur et à l’escalator. Lorsque vous devez être assis longtemps, par exemple pour le travail, ayez le réflexe de vous lever régulièrement pour vous étirer, au minimum toutes les 2 heures. Pourquoi ne pas passer vos appels en marchant ? Si vous avez un animal de compagnie, n’hésitez pas à le promener plus souvent et plus longtemps.
Est-ce possible d’avoir une activité physique lorsqu’on est en fauteuil roulant ?
Lorsqu’on a un handicap moteur et que l’on est en fauteuil roulant, on reste assis toute la journée. Il faut alors veiller à ne pas rester immobile afin de conserver ses capacités motrices et rester en bonne santé.
Certains professionnels de santé peuvent vous aider à bouger si vous êtes assis, comme le kiné, l’ergothérapeute, le psychomotricien ou l’éducateur sportif. En plus de ces séances, c’est bien de bouger un peu tous les jours : s’étirer, danser, faire des mouvements de gymnastique, faire un handisport… Il ne faut pas hésiter à se déplacer tout au long de la journée, même lorsqu’on est en fauteuil. Utiliser ses bras, son dos et ses mains pour se déplacer en fauteuil est une activité physique ! Lorsque vous travaillez au bureau, pensez à vous déplacer toutes les 2 heures.
Quels sont les bienfaits de l’activité physique lorsque l’on est en fauteuil roulant ?
Lorsqu’on est en fauteuil roulant, bouger aide particulièrement à garder un bon transit, de la souplesse et de la force musculaire. Cela évite les déformations, les raideurs et les douleurs dans le corps.
Quelle activité physique pratiquer après 60 ans ?
L’activité physique nous concerne tous, même après 60 ans. Les bénéfices sont réels chez les séniors, notamment pour prévenir les chutes, préserver la masse et la densité osseuse, conserver la souplesse des tendons et des articulations ainsi que les réflexes et la coordination. Pratiquer une activité physique collective permet aussi de lutter contre l’isolement.
Vous souhaitez débuter une activité physique et vous avez plus de 40 ans ? Il est recommandé d’aller voir votre médecin généraliste ou un médecin du sport afin de vous assurer de l’absence de contre-indications. Il pourra réaliser des tests simples visant à évaluer vos capacités sportives et vous conseillera sur les activités les plus adaptées pour vous. Il vous prescrira éventuellement des examens complémentaires comme un bilan sanguin), un électrocardiogramme…
De manière générale, après 60 ans, il est préférable de se tourner vers les activités qui font appel à l’endurance plutôt qu’à la force. Par exemple, les sports de combat et les sports nautiques sont plutôt contre-indiqués. Il est davantage recommandé de pratiquer des sports, tels que la marche, la randonnée, la course à pied, le ski de fond, les raquettes, le vélo, l’aviron, la natation, le yoga, l’aquagym, le tir à l’arc, la danse…
Quelle activité physique pratiquer lorsqu’on est enceinte ?
Il est possible de pratiquer une activité physique lorsqu’on est enceinte, à condition de l’adapter tout au long de la grossesse. Il existe aussi des contre-indications : maladie cardiaque ou pulmonaire, hypertension artérielle mal contrôlée, antécédent de fausse couche… Pensez aux sports doux comme la marche, le vélo d’appartement, la natation, la gymnastique douche, le stretching et l’aquagym.
Qu’est-ce que l’Activité Physique Adaptée ?
L’Activité Physique Adaptée est une activité physique prescrite par le médecin. Elle concerne les personnes qui ont une Affection Longue Durée (ALD).
Quels sont les signes d’alerte, liés à un sport ou à une activité physique, m’indiquant que je dois consulter un médecin ?
Certains symptômes physiques doivent vous motiver à prendre rendez-vous avec votre médecin afin de pratiquer en toute sécurité : une douleur dans la poitrine ou un essoufflement anormal pendant l’effort, ainsi qu’une palpitation cardiaque ou un malaise pendant ou après l’effort. Ne faites pas de sport si vous avez de la fièvre ou un état grippal. Évitez de fumer dans l’heure précédant l’activité et dans les deux heures qui suivent.
Comment me motiver à faire du sport ?
Il existe beaucoup de motivations à faire du sport : se faire plaisir, rencontrer des gens, mieux gérer son stress, prendre soin de son corps et de sa santé… Toutes les raisons sont bonnes ! Il vaut toujours mieux faire un peu d’activité physique que pas du tout. Pour garder votre motivation sur le long terme, entraînez vos amis avec vous et prenez des rendez-vous réguliers. Fixez-vous des objectifs réalistes et savourez vos victoires !
Combien de temps pratiquer une activité physique par jour ?
Il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes d’activités physiques dynamiques par jour pour les adultes et au moins 1 heure d’activités physiques dynamiques par jour pour les enfants et adolescents.
Quand faire du sport dans la journée ?
Il n’existe pas de véritable créneau idéal. En revanche, il est recommandé de ne pas faire de sport, en particulier intense, dans les heures précédant le coucher.
Que manger avant de faire du sport ?
Avant une séance de sport, misez sur les glucides ! Riz, pâtes, céréales… cela vous aidera à faire le plein d’énergie avant l’effort. Idéalement, le repas doit prendre fin 3 à 4 heures avant la séance. Si vous avez faim juste avant la séance, pensez aux fruits (crus, cuits, en compote…). Évitez de manger des aliments trop gras ou trop sucrés.
Que manger après une séance de sport ?
Si vous avez faim immédiatement après l’effort, les fruits sont une bonne option. Pour un repas complet, intégrez des protéines et hydratez-vous bien.
Quand faut-il boire lorsque l’on fait du sport ?
Pensez à boire avant, pendant et après votre séance de sport afin d’éviter de vous déshydrater et de vous blesser. Plus l’effort est long et intense, plus le corps transpire et se déminéralise, et plus il faut boire ! Les boissons énergétiques peuvent être intéressantes à partir d’un certain niveau d’intensité d’exercice, et s’il fait trop chaud.
Ce support a été co-construit et a reçu le soutien de l’Institut National du Cancer et de la Société Française de Médecine de l’Exercice et du Sport.
Cette BD a été mise à jour en janvier 2026 grâce à l’expertise d’Isabelle TETAR de l’association PREV’SANTE MEL, de Brigitte MAINGUET, Claudine FABRE et Georges BAQUET du département Sciences du sport de l’Université de Lille.